POUR QUELLE CULTURE DE LA PAIX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ? PLAIDOYER POUR UNE CITOYENNETE RESPONSABLE
- contacteupcriic
- 12 juil. 2025
- 19 min de lecture
Jacques NGANGALA BALADE TONGAMBA
Enseignant-chercheur à l’Université de Kinshasa, Département de Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; à l’Université de Mbandaka et à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kinshasa ;E-mail : jacquesngangala@gmail.com
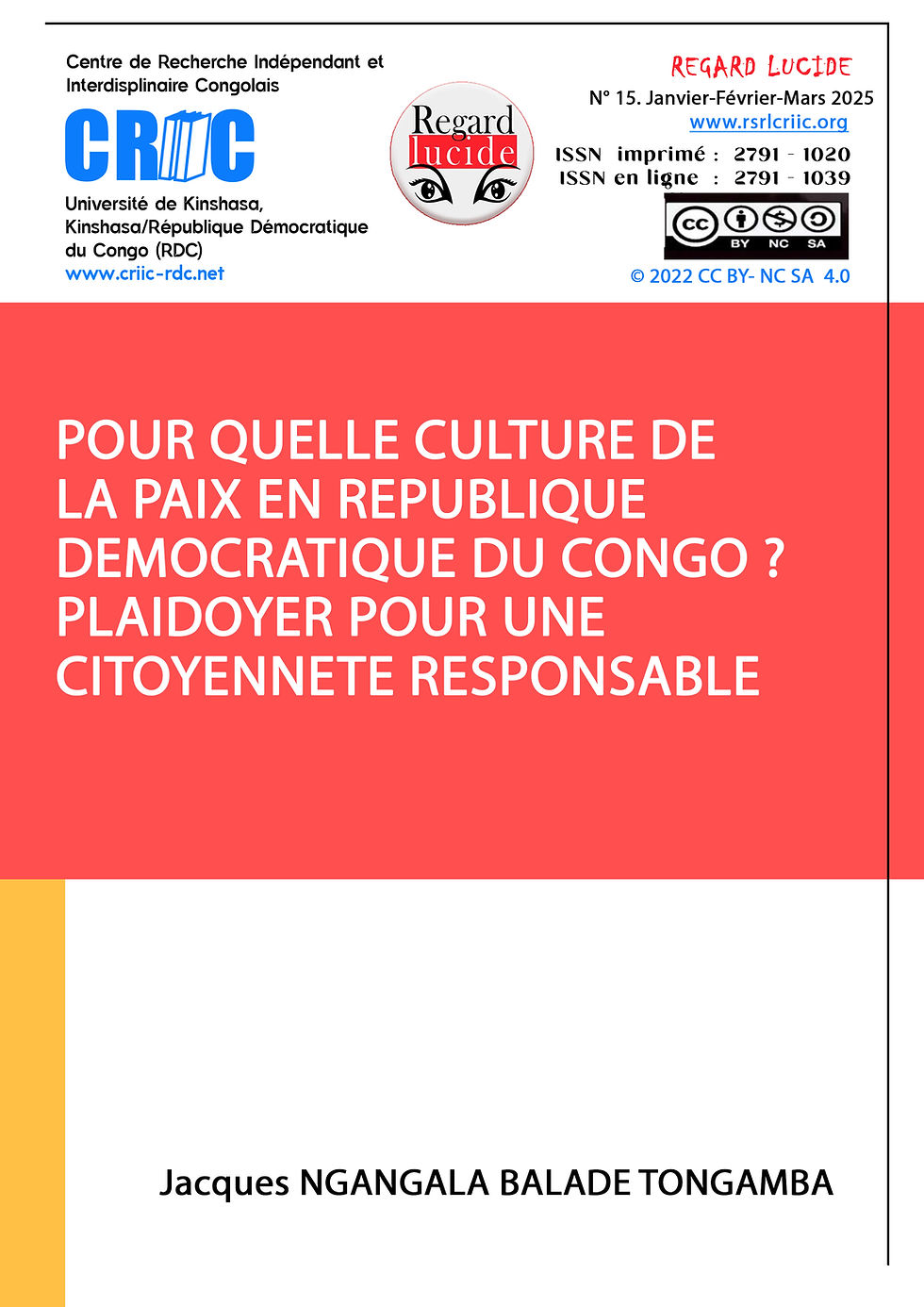
Résumé
Les conflits et violences qui sévissent en République Démocratique du Congo depuis presque trois décennies ne peuvent laisser indifférents les intellectuels de ce pays. Ils sont les faits des hommes et des femmes que, vous et moi, nous sommes. Puisque nous sommes à la base de ces conflits et violences, la solution ne peut arriver que par nous.
Par un jeu de questionnement, les intellectuels congolais résistants dits wazalendo sommes invités à nous interpeller sur la nécessité d’atténuer les conséquences de ces conflits en cherchant les voies et moyens d’y mettre fin. Une de ces voies nous semble celle de forger la prise de conscience de nous, congolais en général, et, plus particulièrement, de l’intellectuel congolais Wazalendo, par le travail de l’éducation à une citoyenneté responsable nécessaire à l’avènement de la justice sociale, de la réconciliation des cœurs entre les fils et filles de pays liés par un destin commun afin de construire un Etat prospère à léguer à notre postérité et à l’humanité tout entière.
Mots clés : Conflit et violence, Culture de la paix, Education à la citoyenneté
responsable, Intellectuel congolais Wazalendo, Bonne gouvernance.
Abstract
The conflicts and violence that have been raging in the Democratic Republic of Congo for almost three decades cannot leave the country's intellectuals indifferent. They are the facts of the men and women that you and me we are. Since we are at the root of these conflicts and violence, the solution can only come through us.
Through a game of questioning, the Congolese intellectuals who are known as wazalendo are invited to challenge us on the need to mitigate the consequences of these conflicts by looking for ways and means to put an end to them. One of these paths seems to us to be to forge the awareness of us, Congolese in general, and, more particularly, of the Congolese intellectual Wazalendo, through the work of education for a responsible citizenship necessary for the advent of social justice, of the reconciliation of hearts between the sons and daughters of countries linked by a common destiny in order to build a prosperous State to bequeath to our posterity and to all humanity.
Keywords : Conflict and Violence, Culture of Peace, Citizenship Education
responsible, Congolese Intellectual Wazalendo, Good Governance..
INTRODUCTION
« Conflits et violence en République Démocratique du Congo. Regards littéraire et philosophique », tel était le thème de la journée d’étude organisée le 23 novembre 2022 à Kinshasa à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe regroupant l’Université de Kinshasa (R.D.C.), l’Université de Bayreuth (Allemagne) et l’Université de Warwick (Angleterre). Elle a connu l’accompagnement de l’Union européenne, European Research Council et Institute for Philosophy de Prague comme partenaires. Ce fut, pour nous, les scientifiques, une occasion de discuter à propos des conflits récurrents que vit depuis presque trois décennies la République Démocratique du Congo, ainsi que des violences sous toutes ses formes que ces conflits entraînent.
Ces conflits et violences sont les faits des hommes et des femmes que vous et moi nous sommes. Voilà pourquoi les organisateurs, venus de divers horizons, nous ont interpellés, nous les intellectuels congolais spécialisés dans les questions de l’homme à émettre des avis par la réflexion. Il s’est agi, non pas seulement de comprendre ces phénomènes de conflits et violences récurrents mais que par ces réflexions, nous puissions entrevoir le bout du tunnel pour toutes les populations qui résident sur ce territoire que nous appelons la République Démocratique du Congo.
Ces faits de guerre et violences, suffisamment documentés par des littéraires et historiens, nous ont permis, grâce à la critique historique et à l’analyse thématique des contenus, d’émettre ces avis par un regard à la fois critique et psychologique.
En ce sens, nous pensons qu’il est plus qu’indispensable d’atténuer les conséquences de ces conflits en cherchant les voies et moyens d’y mettre fin. Une de ces voies nous semble celle de forger la prise de conscience de nous, congolais en général, et, plus particulièrement, de l’intellectuel congolais, par le travail de l’éducation à une citoyenneté responsable nécessaire à l’avènement de la justice sociale, de la réconciliation des cœurs entre les fils et filles de ce pays liés par un destin commun afin de construire un Etat prospère à léguer à notre postérité et à l’humanité tout entière.
1. Les données de la littérature
Il existe une abondante littérature écrite sur les conflits et violences en Républiques Démocratique du Congo dont une bonne partie a été produite par des spécialistes des questions historiques et sociojuridiques.
Dans La guerre des Grands Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique centrale (REYNTJENS 2009, 2000). Une équipe de chercheurs s’est attelée à la recherche des facteurs qui seraient à la base de la violence et des guerres qui sévissent dans la région de grands lacs dont les foyers sont à situer dans la région du Kivu (RDC), du Burundi (1er juin 1993 avec l’élection de Melchior Ndadaye, un Hutu) et du Rwanda (6 avril 1994 reprise des hostilités entre les Hutu et les Tutsi, facteur déclencheur du génocide) avant de se rependre sur l’ensemble du territoire de la RDC, Zaïre de l’époque, de 1996-1997 avec le départ du Maréchal Mobutu Sese Seko (voir e.g. Bechtolsheimer 2012; Inaka 2020, 2023; Lakika and Essex 2024; Lemarchand 1997; Ndaywel e Nziem 1998; Nzongola-Ntalaja 2002).
Examinant les origines, internes et externes, de ces conflits ainsi que leurs incidences tant politiques que sociales ayant fait l’objet des rapports d’enquête internationale, SABAKINU (2002) a dirigé une série des réflexions sur les conséquences de la guerre de la République Démocratique du Congo. Si, pour le pouvoir en place à Kinshasa, cette guerre d’agression est commanditée de l’extérieur pour faire une main basse sur les ressources économiques du pays ; les forces politiques de l’opposition congolaise, quant à elles, voient dans cette guerre une occasion de libérer la population congolaise des affres de la dictature ayant aliéné les outils de l’Etat au service d’une classe politique corrompue.
Dans le premier volume des Actes du Premier Symposium international de l’Université de Kinshasa, des intellectuels congolais des différentes disciplines scientifiques ont statué sur la crise dans la sous-région des pays des grands lacs africain à la recherche de la compréhension de ce phénomène dans le but d’entrevoir les conditions de la paix. Pour les participants, « cette conflagration dont les racines sont intimement associées aux fondements constitutifs de cette sous-région prend corps dans son histoire ancienne et récente. Elle s’inscrit dans un enchevêtrement complexe des facteurs socio-culturels, ethnologiques, économiques, politiques et stratégiques. Représentations socio-idéologiques, migrations de populations, mutations des réseaux de pouvoir ou d’influences y jouent un rôle déterminant » (SABAKINU, AKELE, and MPEYE 2009, 4).
La recherche de la paix véritable ne sera possible que si les vraies causes sont identifiées. MABIALA (2009) fait remonter la cause lointaine au passé colonial et lie ces événements au statut que ce vaste territoire (Association Internationale du Congo, instituée en 1879, et par la suite l’Etat Indépendant du Congo, créé en 1885) avait à la Conférence de Berlin, un domaine privé ouvert au système capitaliste naissant. LUNANGA (2009 ), quant-à-lui, fait le constat que la RD Congo paie le lot d’une mauvaise gestion politique des conflits identitaires dans la sous-région des grands Lacs.
C’est dans ce contexte de la gestion de l’après-guerre, qu’un forum entre Congolais s’est tenu à Pretoria du 10 au 11 Mars 2011, organisé par l’Institute for Global Dialogue, IGD en sigle, un institut indépendant de recherche politique générale basé en Afrique du Sud, portant sur « La Transition en RDC : vers et au-delà des élections de 2011 ». A l’issue de cette rencontre, il a été recommandé la poursuite de ce dialogue par des rencontres du même genre dans les différentes provinces du pays. C’est ainsi que se sont tenues successivement les rencontres de Kinshasa, de Kananga et de Kisangani.
A Kinshasa, le 02 juin 2011, les délégués des provinces du Bandundu, du Bas-Congo, de l’Equateur et de la Ville Province de Kinshasa avaient échangé sur le thème de : «Élargir le consensus pour des élections crédibles et un avenir démocratique» (NGANJE and NGANGALA 2011c). A Kananga, ce fut le tour de regrouper, le 19 août 2011 les délégués provenant des provinces du Kasaï-Occidental, du Kasaï-Oriental et du Katanga autour du thème : «Travaillons ensemble pour des élections apaisées et démocratiques dans une atmosphère de confiance mutuelle et de transparence» (NGANJE and NGANGALA 2011b). La dernière de la série qui s’est tenue le 13 octobre 2011 à Kisangani regroupant les délégués provenant des provinces du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la province Orientale. La session de Kisangani a essayé de recueillir un consensus autour du thème de : « Créer un cadre pour une campagne électorale libre de tout acte de violence, d’intimidation et d’intolérance » (NGANJE and NGANGALA 2011a).
Ces différentes rencontres ont regroupé les acteurs politiques PPRD, MLC, MSR, UDPS, ARC, UNC, FLNC, CENI, Action Jeunesse, Radio Okapi. Tous ces acteurs ont assuré une durabilité au processus électoral apaisé et ont été invités à s’engager, dans leurs promesses électorales, pour la redevabilité, la transparence, la participation citoyenne et la lutte contre la corruption et la fraude électorale. S’il y a eu quelques points de désaccord à Kananga comme à Kisangani, il se rapporte à la demande de l’opposition de mettre sur pied une commission chargée de la certification des résultats et du contentieux électoral(NGANJE and NGANGALA 2011c; NGANJE and NGANGALA 2011b, a).
En dépit de ces efforts de ramener la paix par l’organisation des élections apaisées, le mouvement rebelle identifié M23 reprendra ses offensives en occupant une bonne partie du Nord-Kivu, avec la ville de Goma, en 2012. C’est dans ce contexte que Ngoie Tshibambe va s’interroger, après la reconquête de cette partie du territoire national par l’Armée gouvernementale, sur les causes qui expliqueraient la récurrence de ces conflits et violences. Et à ce propos, il va épingler les questions identitaires entre congolais d’une part et la convoitise des ressources naturelles par des pays tiers d’autre part (Ngoie, 2014).
C’est également le point de vue de MABIALA (2020) qui situe les questions identitaires, qui se posent dans la région de Grands Lacs, entre les années 1910 et 1960 tout en responsabilisant le pouvoir colonial belge.
La guerre dans les Grands Lacs Africains a pris une dimension internationale depuis son déclenchement en 1996. C’est dans ce contexte que la Mission des Nations Unies pour la Sécurité au Congo, la MONUSCO en sigle, est depuis lors à l’œuvre. Pierre Bodeau-Livinec s’est penché sur la mission de l’ONU et le bilan qu’on peut en tirer après autant d’années d’existence. Il remet en cause certains outils utilisés qui rendent inopérant certaines de ses actions et relance la question de sa réforme, principalement la composition et le pouvoir de son Conseil exécutif (BODEAU-LIVINEC 2021).
Comment ramener la paix dans la région de Grands Lacs sans le concours de la justice ? Des voies ont commencé à s’élever pour appeler à l’établissement d’une justice pénale internationale dans cette région d’Afrique où les conflits et violences deviennent endémiques. Des activistes de Droit de l’homme de la République Démocratique du Congo prennent la parole au nom de l’Association « Culture pour la liberté et la justice » pour exiger la mise en œuvre du statut de Rome, et plus particulièrement à l’application de la peine de mort dans le pays. Bien que la RDC ait ratifié le statut de Rome et aie renvoyé une situation devant la Cour Pénale Internationale, notre pays n’intègre pas dans sa constitution (loi domestique) ce statut de Rome. En évaluant le débat en cours sur la peine de mort et ses implications pour la mise en œuvre du statut de Rome, les activistes de Droit de l’homme, par le canal de Liévin Ngombe, identifient certaines contradictions à cet égard entre les lois de la RDC et le droit pénal international (Ambos and MAUNGANIDZE 2012).
Par cette revue de littérature, une certitude se présente à nous quant aux causes de cette guerre récurrente en RDC : la question identitaire entre congolais d’une part et la convoitise des ressources naturelles de ce pays par des pays tiers d’autre part. C’est depuis plus de trente ans que la République Démocratique du Conge vit sa longue guerre. Pour nous, les Congolais, tantôt c’est une guerre de libération, tantôt c’est une guerre d’agression selon qu’on est proche de l’opposition ou proche du pouvoir.
Sommes-nous, en Afrique, le seul pays convoité pour ses ressources et où il se pose un problème de cohabitation entre les citoyens ? Pourquoi notre guerre en République Démocratique du Congo devient récurrente au risque de sacrifier des générations entières ?
Il nous faut rompre avec cette spirale de violences en cherchant de bonnes solutions d’une véritable paix. Et pour ce, «l’instauration de la paix dans la région des Grands Lacs ne se fera pas en dehors de la vérité historique » (MABIALA 2020). Cet historien estime que « Le pouvoir colonial a œuvré à la création des relations sociales fondées sur le particularisme historique ou la spécificité culturelle. La politique d’exclusion et d’hétérogénéisation l’emportait sur les mesures d’inclusion». Ainsi apparait clairement que les origines de cette longue guerre sont anciennes et complexes.
Devrions-nous, congolais, continuer à responsabiliser les autres comme causes de nos malheurs ? La République Démocratique du Congo devra assumer son destin, fruit d’une longue histoire que nous devons apprendre à nos enfants et petits-enfants.
2. Les raisons de la guerre et de la paix
La guerre, c’est l’absence de la paix ! Et pourtant, qui veut la paix prépare la guerre, dit-on ! C’est quoi la guerre ? C’est quoi la paix ?
La guerre, apparemment se définit très bien comme un conflit entre deux Etats ou deux nations. Mais, apparemment aussi, la paix n’est jamais définie que comme absence de guerre, comme trêve entre deux guerres. Et dans le contexte qui est le nôtre, c’est comme si, les gens, fatigués de faire une guerre, restent pendant un certain temps à préparer une autre guerre, et c’est cela qu’on pourrait appeler la paix. Le vrai chemin vers la paix, serait-ce la préparation d’une autre guerre ? La paix véritable n’est-elle pas un combat contre la guerre sous toutes les formes et par tous les moyens ?
Ces constats et interrogations illustrent bien ce qui se passe dans notre pays où la guerre oppose aussi bien notre nation avec d’autres que les Congolais entre eux et que les raisons de la guerre sont les mêmes que celles de la paix. Cependant, la guerre et la paix en République Démocratique du Congo se décident ailleurs et par les autres pays. Ne faudrait-il pas que les guerres en République Démocratique du Congo deviennent les guerres entre congolais et que la paix à construire soit aussi notre paix ?
Les causes lointaines des conflits en République Démocratique du Congo semblent être la Conférence de Berlin et la Constitution, pour des fins extérieures de l’Association Internationale du Congo qui deviendra Etat Indépendant du Congo constitué des sociétés politiquement organisées[1]ayant fait allégeance pour se prémunir contre les esclavagistes qui écumaient cette vaste région d’Afrique du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Etat Indépendant ne signifiait pas ici peuple souverain mais bien un vaste territoire officiellement reconnu par les puissances internationales de l’époque comme une propriété privée du roi des Belges Léopold II à l’issue de la Conférence de Berlin le 30 avril 1885 et institué par Décret royal le 29 Mai 1889 et, par-là, source des rivalités entre ces puissances internationales. Il faut ajouter à cela une colonisation par la Belgique allant du 15 novembre 1908, à la suite d’une exploitation brutale des populations autochtones par les compagnies concessionnaires, et une décolonisation le 30 juin 1960, mal négociées et la guerre froide entre les superpuissances dans laquelle la République Démocratique du Congo est un des enjeux majeurs.
Quant aux causes immédiates de la longue guerre que nous sommes en train de connaître, il y a lieu de croire qu’elles sont externes et internes : la lutte entre puissances internationales pour l’appropriation de l’Afrique, une mauvaise gouvernance de l’Etat par les institutions politiques, la pauvreté accrue et l’illusion démocratique. Et les raisons qui ont fait que la guerre dure sont probablement les intérêts économiques des puissances et leur désir de balkanisation du pays, le clientélisme politique dans la gouvernance de l’Etat et le manque de cohésion interne pour affronter les prédateurs.
La paix future est certainement conditionnée par la prise de conscience de la force que nous constituons, la sortie à tout prix de la pauvreté et la gestion intelligente des forces qui nous entourent.
Il y a lieu ainsi de comprendre que nos guerres, surtout en République Démocratique du Congo, sont des guerres qui viennent d’ailleurs. Mais on se pose toujours la question : cela vient d’ailleurs mais qui font ces guerres ? C’est nous ! Et c’est souvent entre nous ! Mais pourquoi on ne refuse pas de faire la guerre quand on nous demande de la faire ? Pourquoi nous n’arrivons pas à refuser de faire des guerres imposées par d’autres ?
Parce qu’en fait, c’est l’homme congolais qui doit prendre cette décision de faire la guerre ou de ne pas la faire. Et malheureusement, nous prenons toujours la décision de faire la guerre. Mais pourquoi ne prenons-nous pas la décision de ne pas faire la guerre ? Probablement, parce que nous ne comprenons pas ce qu’« être congolais » signifie ! « Être congolais » c’est assumer le destin d’ « être Africain » (FANON 1952). Être-congolais devrait nous obliger à nous ressourcer dans notre histoire passée et présente pour construire notre avenir d’une humanité partagée ! Le combat véritable réside dans la reconquête de notre identité. Une identité dynamique et non figées dans des stéréotypes désuets d’un passé qui n’existe plus et rétrograde oubliant des apports divers de notre histoire récente qui nous définissent dans l’existence réelle et non imaginaire ! Le vrai combat pour la reconquête de notre identité, dans un contexte de la globalisation ne devrait-il pas être orienté vers la lutte contre l’aliénation, contre l’ignorance, contre la pauvreté, contre la paresse et contre l’obscurantisme ?
En définitive, il est question de l’homme congolais qui doit être formé sur le plan moral, ontologique et scientifique. Voilà le vrai front auquel nous devons unir nos forces pour la conquête de notre dignité, de notre liberté, de notre développement. Réconcilions-nous avec notre histoire passée et présente pour une citoyenneté responsable et émancipatoire pour les générations futures!
2. Pour une citoyenneté responsable
On ne devrait peut-être pas désespérer de cette guerre. Il y a une question qu’on peut se poser : qu’est-ce que nous avons gagné de ces guerres parce qu’il y en aura encore d’autres ?
Depuis l’accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté politique, les velléités de "balkanisation" ont toujours secoué ce pays. Ces velléités ont des causes tant internes qu’externes : un pays continent, aux ressources naturelles immenses ; habité par une population diversifiée et partageant un destin commun, désireuse de vivre ensemble mais croupissant dans une misère innommable !
C’est depuis plus d’un quart de siècle, à partir de 1996, que la République Démocratique du Congo est en proie à son destin. Lequel destin est bien porté par les premiers mots de l’hymne national Debout Congolais, puisque nous sommes unis par le sort (Conférence de Berlin, colonisation), c’est par l’effort que nous allons maintenir cette unité qui est la condition de notre souveraineté politique !
A la question de savoir ce que ce pays a gagné avec ces guerres et violences récurrentes, nous pensons avoir gagné beaucoup de choses. Apparemment ce que nous avons gagné, c’est le fait que le pays n’a pas été disloqué. C’est, au moins cela, une victoire que tout véritable congolais devrait capitaliser !
Au-delà de la guerre, de nos morts, de nos déplacés des guerres, de la pauvreté généralisée, il y a le constat d’une résistance profonde de ce peuple portée par une résilience à toute situation extrême. Pourquoi cette résistance ? Parce que la volonté de résister est en nous malgré nos faibles moyens !
Le symbole de cette résistance se manifeste dans l’ensemble du territoire national où dans toutes les 26 Provinces qui constituent la République Démocratique du Congo, nous assistons à un éveil nationaliste et patriotique, un éveil de la conscience citoyenne que le politique congolais devra capitaliser.
Cette conscience citoyenne devrait être le socle du lien social entre les filles et fils de ce pays au-delà de nos diversités héritées de notre histoire et géographie communes. La citoyenneté est notre identité sociale dans les États modernes (SCHNAPPER 2000, 10), elle implique que chacun de nous, moi et toi, construisions une société politique sur base des valeurs citoyennes et non à partir de nos affinités tribales, religieuses ou clientélistes.
Cette construction ne peut advenir que par la promotion des valeurs de discussion, toujours régler nos différents par la palabre ; de l’engagement, ne pas rester au niveau des débats mais agissons dans la vérité issue de ces débats ; de la responsabilité, toujours être disponible pour rendre compte de nos devoirs à la communauté, la redevabilité (Okolo, Préfacier de Charles Mbadu, 2011, p.9-15).
L’arbre à palabre dans le village en Afrique est le seul lieu de rencontre qui n’exclut personne et où tout différent qui met en péril la quiétude du village se règle par le partage de la parole sous la conduite des anciens (KAMWIZIKU 1994). La discussion comme une valeur citoyenne devrait être privilégiée en cas des différents dans la société. Discuter c’est parler ! Parler c’est écouter ! Écouter c’est comprendre pour démêler le vrai du faux, le bien du mal et le beau du laid!
La discussion ne peut aboutir que dans un espace de distribution des rôles sociaux selon les capacités des uns et des autres forgées par l’éducation initiatique des enfants. Cette dernière consiste à exercer l’intelligence et la volonté de l’enfant dans le seul but de son insertion sociale. L’engagement social au village se démontre par la capacité à se bâtir un logis, à s’assurer une autonomie dans le travail de champs, de la pêche, de la chasse et du négoce pour garantir la construction du ménage afin de perpétuer le clan !
Au village chacun cannait sa place dans la société et sait à quoi il répond. La responsabilité sociale est fonction de la responsabilité morale qui est la tâche première de toute famille dans le village. Les charges sociales sont dévolues aux personnes capables de les assumer et d’en rendre compte à la société sous l’arbre à palabre. La redevabilité devrait être la condition première de toute charge publique pour tout congolais qui se dit citoyen.
CONCLUSION
Que dire encore ? Guerre d’agression ! Guerre de libération ! Des Congolais agressent d’autres Congolais ! Des Congolais libèrent d’autres Congolais ! Tous, devenons des Wazalendos, des résistants congolais à l’image de Jeanne d’Arc qui s’est sacrifiée pour la France-libre ! Il nous faut continuer à résister tant que l’agression continuera sans céder à brader notre identité chèrement conquise depuis les nuits du temps. Que le politique emboîte le pas au citoyen Wazalendo qui résiste à l’agression ; qu’il nous garantisse une gouvernance citoyenne et non prédatrice et clientéliste du pays. Que cette guerre devienne politique pour une conquête démocratique du pouvoir afin de libérer le congolais de la faim, de l’injustice, de la marginalisation, de la discrimination, de la mystification !
Notre pays, la République Démocratique du Congo soufre d’un mal qui a pour nom, l’homme politique congolais. Cet homme refuse de servir son pays mais pense se servir du pays pour assouvir ses passions ! Cet homme politique congolais devrait savoir que les institutions politiques ont pour mission fondamentale de créer les conditions les meilleurs pour le Bien-Vivre-Commun (MBOLOKALA 2010; NGOMA-BINDA 2017).
Dans son rapport synthèse 2023 sur la situation alimentaire de la république Démocratique du Congo, un organisme des Nations Unies dresse un tableau très sombre du fonctionnement de nos institutions où le clientélisme paralyse tout l’appareil de l’Etat congolais tant au niveau central qu’à celui des entités décentralisées. Ce mal consiste à bannir les prescrit de la loi écrite au profit des « pratiques non-écrites mais négociées » qui déterminent l’action des autorités et des agents de l’Etat. Et cela a pour conséquence « la privatisation des services étatiques » d’une part et la résurgence « des interactions entre l’Etat et les particuliers » d’autre part. Dans cette nouvelle configuration d’attribution des rôles, les agents de l’Etat utilisent les structures étatiques et leur propre rôle dans ces hiérarchies comme « activités génératrices de revenus pour eux et pour leurs supérieurs ». Dans ces conditions, on ne devrait pas s’étonner de constater l’affaiblissement, de jour en jour, de l’autorité de l’Etat et l’alimentation de la contestation politique (F.A.O 2023).
De cette longue guerre, nous ne devrions pas désespérer, car après une longue pluie, le beau temps finira par apparaitre. La fin du Moyen-âge européen a coïncidé avec la guerre de cent ans qui a opposé la France à l’Angleterre et qui a fini, au XVIème siècle, par de grandes mutations politiques et sociales grâce au développement de la science et des arts. La renaissance africaine tant attendue devra éclore un jour !
Il nous faut aussi nos héros wazalendos au niveau scientifique, les intellectuels congolais wazalendos, à l’image de Jeanne d’Arc de la France-Libre, pour réveiller l’espoir de la population congolaise !
Que la gouvernance politique en prenne conscience et s’engage à recréer sans le nier la République Démocratique du Congo (OKOLO O. and NGANGALA 2018) dans la Paix, la Justice et le Travail. Une paix, non seulement marquée par l’absence des guerres entre Etats ou nations, mais un état de quiétude indispensable à l’épanouissement du citoyen et de tout expatrié qui aura choisi notre pays comme seconde patrie. Une justice qui garantit à chacun la jouissance de ses droits en respectant ceux d’autrui, telle est la norme de l’égalité. Le travail, qui est la manifestation concrète de cet épanouissement en se rendant non seulement utile à soi-même mais aussi à la communauté à laquelle on appartient.
Cela ne sera possible qu’avec le concours des intellectuels congolais wazalendos qui auront compris qu’ils n’ont qu’une seule Nation et une seule Patrie, la République Démocratique du Congo, leurs léguer par leurs aïeux.
Quelle terre, quel État, quelles valeurs de notre identité allons-nous léguer à nos enfants et petits-enfants ?
REFERENCES
Ambos, KAI, and OTTILA A. MAUNGANIDZE. 2012. Pouvoir Et Poursuite. Défis Et Opportunités Pour la Justice Pénale Internationale en Afrique SubSaharienn. Universitätsverlag Göttingen.
Bechtolsheimer, Götz. 2012. "Breakfast with Mobutu: Congo, the United States and the Cold War, 1964-1981." London School of Economics and Political Science.
BODEAU-LIVINEC, Pierre. 2021. Le conseil de sécurité des Nations Unies : entre impuissance et toute-puissance. Paris: CNRS Éditions.
F.A.O. 2023. "République démocratique du Congo: Analyse de conflits dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu, Note de synthèse.", accessed 8 avril. . https://doi.org/10.4060/cc8227fr
FANON, FRANTZ. 1952. Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil.
Inaka, Saint José. 2020. "Post-war Labour Market Reconstruction: The Case of the Democratic Republic of the Congo." University of Pretoria
Inaka, Saint José. 2023. "The Post-War Power Sharing and the Legal Politicisation of the Congolese Public Administration." South African Review of Sociology 53 (2):150-169.
KAMWIZIKU, W. 1994. " Le village philosophique. Essai sur le fonctionnement parémiologique de la palabre africaine." R.P.K. 8 (13):107-121.
Lakika, Dostin, and Ryan Essex. 2024. "“Tokowa po ya ekolo”: The Military Body Within the Congolese Army." Armed Forces & Society 50 (2):520-538.
Lemarchand, René. 1997. "Patterns of state collapse and reconstruction in Central Africa: Reflections on the crisis in the Great Lakes Region." Africa Spectrum:173-193.
LUNANGA, BUSANGA W. Joseph. 2009 Géopolitique et conflits identitaires en République Démocratique du Congo. Kinshasa: Éditions Compodor.
MABIALA, Mantuba-Ngoma Pamphile. 2009. Systèmes capitalistes et guerres post-coloniales en RDC », dans Images, Mémoires et Savoirs. Vol. Paris: Karthala.
MABIALA, Mantuba-Ngoma Pamphile. 2020. Pouvoir colonial belge et fluidité des identités dans la région des grands lacs (1910-1960). Edited by N° XXI Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Kinshasa: PUZ.
MBOLOKALA, Imbuli. 2010. Pour un bien-vivre-ensemble de l’Humanité. Kinshasa: Cerdaf.
Ndaywel e Nziem, Isidore. 1998. Histoire générale du Congo: de l'héritage ancien à la République Démocratique, (No Title). Paris et Bruxelles: De Boeck et Larcier.
NGANJE, Fritz, and Jacques NGANGALA. 2011a. Créer un cadre pour une campagne électorale libre de tout acte de violence, d’intimidation et d’intolérance,. Kisangani: Rapport général IGD.
NGANJE, Fritz, and Jacques NGANGALA. 2011b. Travaillons ensemble pour des élections apaisées et démocratiques dans une atmosphère de confiance mutuelle et de transparenc. Kananga: Rapport général IGD.
NGANJE, Fritz, and Jacques NGANGALA. 2011c. Élargir le Consensus pour des Élections Crédibles et un Avenir Démocratique, Rapport général IGD. Kinshasa: IGD.
NGOMA-BINDA. 2017. L’essence de l’authenticité. Une éthique du désir d’être. Paris: l’Harmattan.
Nzongola-Ntalaja, Georges. 2002. The Congo: From Leopold II to Kabila: A People’s History. London: Zed Book.
OKOLO O., B , and Jacques NGANGALA. 2018. Introduction à l’histoire des idées dans le contexte de l’oralité. Théorie et méthode avec application sur l’Afrique traditionnelle. Louvain-la-Neuve: Académia l’Harmattan.
REYNTJENS, Filip. 2000. La guerre des Grands Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique Centrale. Paris: L’Harmattan.
REYNTJENS, Filip. 2009. The great African war: Congo and regional geopolitics, 1996-2006. New York Cambridge University Press.
SABAKINU, Kivilu. 2002. Les conséquences de la guerre de la République Démocratique du Congo en Afrique centrale. Kinshasa: PUK.
SABAKINU, Kivilu , Adau AKELE, and Nyango MPEYE. 2009. La crise dans la sous-région des pays des grands Lacs africains. État de la question et perspectives de paix. Actes du Premier Symposium international de l’Université de Kinshasa, Tome 1. Kinshasa: PUK.
SCHNAPPER, D. 2000. Qu’est-ce que la citoyenneté ? . Paris: Gallimard.
[1] « Dans l’Afrique centrale du XIXe siècle, l’histoire politique et sociale s’inscrit d’abord dans une tradition ancienne. Aussi loin que la documentation orale et écrite permette de remonter, on voit que les sociétés de la région ont hésité entre deux modèles de pouvoir : celui, hiérarchisé, défini, tributaire, des royaumes ou, à l’autre extrême, celui, plus égalitaire et plus informel, du gouvernement par des conseils d’anciens ou de notables » A. ADU BOAHEN (Dir.), Histoire générale de l’Afrique. L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, V.VII, Paris, Éditions UNESCO, 1987, p. 352.


Commentaires